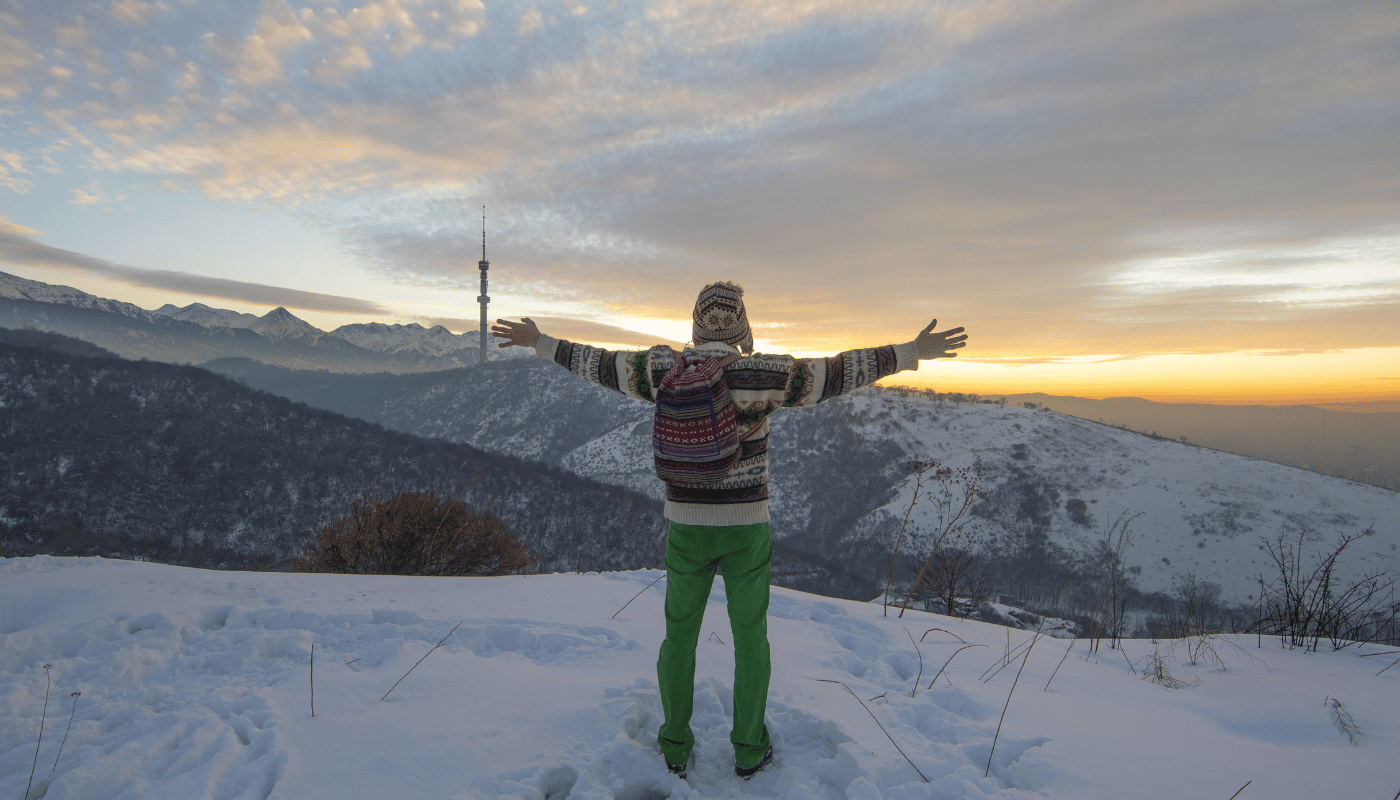Michael Charavin Kite Ski Island
Pourriez-vous nous parler de votre première grande traversée, la Scandinavie du Sud au Nord ?
En 1999, à 29 ans, j’ai fait une première tentative de traversée Sud-Nord de la Scandinavie en autonomie. J’avais alors l’expérience de la montagne, j’étais déjà assez calé en orientation/navigation. Mais je ne suis pas parvenu à aller très loin dans cette tentative, car ma préparation n’était tout simplement pas suffisante. D’abord, le point de départ choisi pour ce long voyage était à la périphérie des montagnes, dans un secteur où l’enneigement était insuffisant. Cela m’a valu un premier échec seulement quelques heures après le départ, et la nécessité de réorganiser un second démarrage quelques jours plus tard. J’avais, par ailleurs, organisé des dépôts de nourriture pour une durée de voyage de 100 jours, mais je n’avais pas pris le soin d’ordonner chacun de ces ravitaillements. J’ai également eu rapidement un souci technique avec l’une de mes chaussures (une semelle décolée) et ne pouvais plus continuer à skier avec. Enfin, je crois que je n’étais pas tout à fait prêt à faire cette traversée seul. La solitude me pesait.
Fort de cette expérience, j’ai organisé, durant l’année qui a suivi, une logistique plus appropriée et j’ai à nouveau tenté la traversée de la Scandinavie durant l’hiver 2000 – accompagné par cinq amis qui se relayaient et qui m’attendaient chacun à un endroit précis du parcours. La première partie de la traversée a été très difficile. Je n’avais alors pas de GPS, mes seuls outils de navigation étaient des cartes au 1/100 000e et une boussole. Pendant un mois, nous avons progressé sur les immenses plateaux du sud de la Norvège, sans repère et dans des conditions météo souvent difficiles. Ce fut une sacrée expérience ! En raison de la météo exécrable, nous avons passé la plupart des nuits en refuge, en tout cas lors de la première moitié du périple. À plusieurs reprises, nous n’avons pas pu pénétrer dans les refuges tant la neige accumulée depuis novembre recouvrait entièrement leurs façades.
Et la traversée Sud-Nord du Groenland en mai 2008, 2 300 kilomètres en trente et un jours, est-ce l’expédition la plus difficile que vous ayez faite ?
Je n’ai pas ce sentiment-là. J’ai passé beaucoup de temps à préparer cette expé – deux ans. J’avais aussi beaucoup plus d’expérience que pour la Scandinavie. Les conditions météo étaient dans l’ensemble très satisfaisantes. Il n’y a pas eu de tempête. Les températures remontent à cette période de l’année. Il faisait -5°C au Sud et au minimum -25°C au Nord. Ce ne sont pas là des températures extrêmes. Bon, il faut tout de même relativiser mes propos ! Kiter par -20°C n’est pas anodin, car le vent, ajouté à notre propre vitesse de progression (jusqu’à 60 km/h en conditions d’expédition), abaisse clairement la température ressentie par le corps. Le terrain, même s’il peut sembler plat, n’était pas non plus une sinécure – nous avons rencontré des sastrugis, des sortes de vagues dures formées par le vent, avec des arêtes franches de 20 à 50 centimètres de hauteur, sur un tiers du parcours (environ 800 kilomètres). Nos prédécesseurs sur cette « route » n’avaient pas témoigné de cette difficulté… Nous avons skié 10, 12 voire 14 heures par jour. Nous ne sommes jamais allés au-delà des 200 kilomètres parcourus dans une journée, mais, en revanche, nous étions très réguliers, parcourant jour après jour environ 150 kilomètres. Je ne me suis jamais senti atteindre mes limites, même si j’avais régulièrement « ma dose ». Une seule fois, nous avons eu très froid et avons pris des précautions particulières pour éviter les gelures.
Non, honnêtement, cette expédition ne m’a pas semblé extraordinairement dure, parce qu’elle correspondait à ce pour quoi nous nous étions préparés.
La traversée Sud-Nord de la Scandinavie peut paraître beaucoup plus simple que la traversée du Groenland, car la Scandinavie n’est pas une région polaire à proprement parler. Mais c’est en réalité un territoire qui peut être très hostile et la difficulté de la traversée n’a rien à envier à celle du Groenland.
Il en est d’ailleurs de même de l’Islande. L’ampleur de notre projet d’expé en Islande, en 2010, pouvait sembler modeste au regard de la traversée longitudinale du Groenland. Pourtant, l’itinéraire parcouru à travers les contrées les plus reculées de l’Islande n’a pas été moins exigeant et original. Si l’enjeu principal de l’expé groënlandaise reposait sur nos capacités et notre efficacité à couvrir quotidiennement de longues distances, en Islande, le challenge a été tout autre. La calotte glaciaire du Vatnajökull est précisément située sur le rift, un lieu d’une sismicité fréquente et d’éruptions volcaniques répétées, caractérisé par la présence de profondes failles qui peuvent se matérialiser à la surface de la calotte par des crevasses. Par ailleurs, le relief est souvent complexe en Islande. Progresser sur des terrains déversants, parfois peu enneigés, très irréguliers et semés d’obstacles – laves affleurantes, ruptures fortes de pentes, corniches neigeuses, ravins – exige un bon niveau technique en kite afin d’éviter les pièges qui peuvent provoquer des chutes ou la casse du matériel. Il faut également composer avec les perturbations aérologiques induites par le relief. Il convenait de redoubler d’attention vis-à-vis de ces microphénomènes (rafales, venturi, rouleaux, rotors, abris, déventes, etc.). La dernière des contraintes en Islande, et pas la moindre, est de faire avec les aléas d’une météo capricieuse. Précipitations et vents sont les maîtres incontestés de ces arpents de terre. Les conditions là-bas peuvent donc être très extrêmes. Elles l’ont été en 2010. Nous avons eu à plusieurs reprises des vents à 100 km/h. Nous avons réussi à kiter par des vitesses de vent approchant les 70 km/h, sans aucune visibilité, avec un risque bien réel de se perdre l’un l’autre. Des moments anxiogènes !
Comment préparez-vous une expédition ?
La préparation d’une expédition est le plus souvent un travail d’équipe. Nous passons tout d’abord du temps à définir précisément le projet en se renseignant notamment sur ce qui a déjà été fait et en cherchant les données disponibles sur les conditions climatiques, météo et aérologiques du secteur visé. Puis vient le temps de la logistique (itinéraire, équipement, envoi de frets, autorisations, assurances, réservation des vols, choix des voiles, etc.).
Avant la traversée du Groenland en 2008, nous sommes allés en Norvège à plusieurs reprises afin de pratiquer le kite dans des conditions relativement proches de celles que nous allions rencontrer au Groenland. Lors de ces voyages préparatoires, nous avons rencontré des Norvégiens qui avaient déjà effectué de grandes traversées en kite (notamment la traversée du Groenland du Sud au Nord réalisée en 2005 et dont l’équipe détient encore à ce jour le record de vitesse). Le témoignage de leur expérience a été précieux.
En kite, il est indéniable que les paramètres météo et aérologiques du moment jouent un rôle déterminant dans la réussite d’un projet. Il est donc primordial de procéder, en amont, à un important travail de préparation afin de définir le parcours idéal à une progression aéro-tractée, ainsi que les nombreuses variantes et réchappes envisageables en cas de nécessité (vents défavorables, tempêtes durables, dégel violent, déneigement marqué, casse matérielle ou corporelle).
Pour la traversée de la calotte glaciaire du Vatnajökull, en Islande, nous avons interrogé nos amis islandais qui connaissent et pratiquent les lieux reculés de ce pays : enneigement classique des zones non glaciaires, état d’englacement des rivières, zones particulièrement crevassées sur les calottes glaciaires, routes traditionnellement empruntées par les expéditions (4×4, snowscooters, secours islandais), possibilités de replis, accès aux refuges, etc.
En parallèle, nous avons cherché à collecter des informations précises concernant le climat : ses principaux systèmes météorologiques (positionnement et évolution des cellules dépressionnaires) et leurs caractéristiques (directions classiques des vents, précipitations, températures, etc.).
A suivi un important travail cartographique : collecter l’ensemble des cartes topographiques au 1/50 000e (échelle la plus précise en Islande) sur une large bande Nord-Est / Sud de l’île, analyser en détail la topographie des 400 kilomètres envisagés de façon à dessiner un itinéraire optimal à la progression sous voile, ainsi qu’un ensemble de variantes qui pourraient être utilisées selon les conditions (direction du vent, enneigement) du moment, numériser l’ensemble des cartes, les rabouter et les calibrer afin de leur donner un format de navigation pratique sur GPS.
La préparation des itinéraires se termine généralement par l’envoi de prévisions météo, qui nous permettent de nous rendre compte du temps à attendre et d’étudier nos options de progression en kite (cette dernière phase de préparation est souvent déterminante car elle doit nous indiquer si l’itinéraire que nous avons prévu est toujours d’actualité).
Parlez-nous des risques d’une telle expédition.
Bien sûr, il existe des risques dans ce type d’expéditions, comme dans tous les sports extrêmes. Il est important de bien les prendre en compte. Pour un expéditionniste, la préparation, l’anticipation, la concentration et la détermination sont des éléments clés de la réussite, mais pas de la sécurité. Il peut arriver que malgré toute l’attention que l’on porte à ses préparations, à son équipement, à la qualité de son matériel, on se heurte à un accident imprévu.
En kite, par exemple, des accidents peuvent survenir – une chute sur des terrains dénivelés, des vents violents entraînant des chutes, des vagues brisées ou des obstacles naturels. Il est également nécessaire de prendre en compte les dangers inhérents au froid : les gelures ou autres accidents corporels (hypothermie). J’ai eu des gelures aux doigts en 2000, lors de ma première expédition ; je n’avais pas bien prévu mon équipement pour résister au froid, je m’étais trop appuyé sur la résistance que j’avais développée au cours des années.
Sur le long terme, la fatigue peut également entraîner des erreurs de jugement qui deviennent des risques accrus. Je ne peux m’empêcher de penser à l’une de mes premières sorties en kite ski au Sud de la Norvège, avec un ami. Nous avions traversé la plus grande partie du pays, mais nous avons dû changer notre itinéraire en raison de l’état de la neige qui était devenue très molle. À plusieurs reprises, nous avons croisé d’autres expéditions qui avaient choisi de faire demi-tour. Mais nous étions à mi-chemin de notre objectif, le ciel était clair et je me sentais très bien. En raison de ce sentiment de bien-être, j’ai pris la décision d’ignorer mes doutes quant à notre capacité à passer cette zone molle et très instable. Nous avons passé trois jours dans un dédale très technique, pris par la fatigue, la température, la fatigue, la concentration. Ce fut finalement une très mauvaise idée et nous avons mis en danger notre sécurité et la réussite de notre projet. Il est essentiel de savoir garder la tête froide, d’anticiper le pire et de faire preuve de sagesse.
Pour finir, quel est le point le plus marquant de ces expéditions ?
Sans hésitation, les rencontres humaines. C’est cela qui nous pousse à poursuivre nos rêves. En route, nous avons croisé de nombreuses personnes, que ce soient des expéditionnistes, des populations locales, des secouristes, des amis, des personnes rencontrées par hasard, etc. Leurs histoires, leur gentillesse et leur aide ont été des atouts précieux dans nos projets. Nous avons également croisé des animaux dans ces contrées éloignées : des phoques, des morses, des ours polaires, des rennes, etc. Ils nous rappellent que nous ne sommes que de passage sur cette terre. Leurs comportements souvent inattendus nous rappellent aussi à quel point il est primordial de respecter la nature.
Enfin, je dirais que ces expéditions sont une façon d’apprendre à mieux me connaître, de dépasser mes limites, d’affronter mes peurs et d’être en phase avec la nature, tout en partageant ces moments précieux avec mes amis et les personnes rencontrées. Je suis également convaincu que ces projets apportent une belle leçon d’humilité. Cela m’aura également appris à être résilient et à voir la beauté de chaque expérience, qu’elle soit positive ou négative.